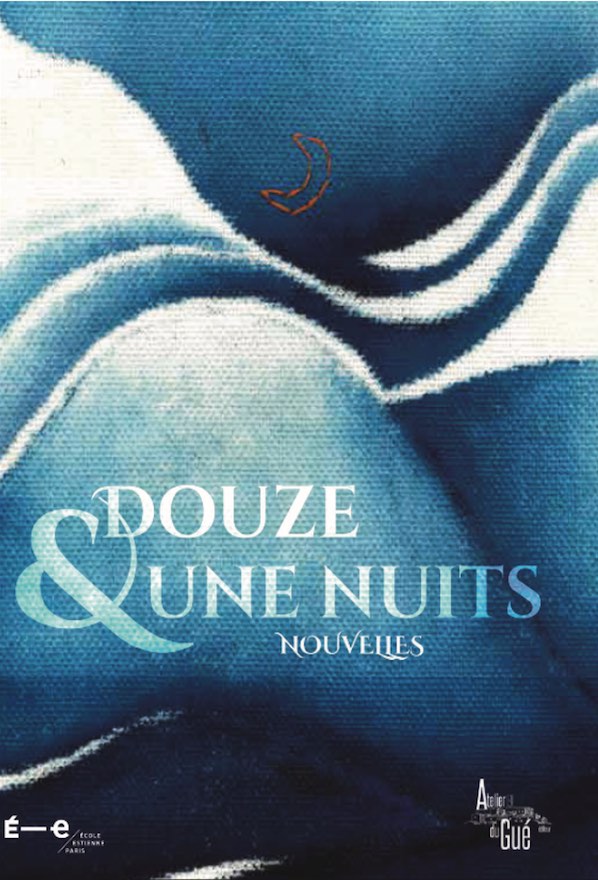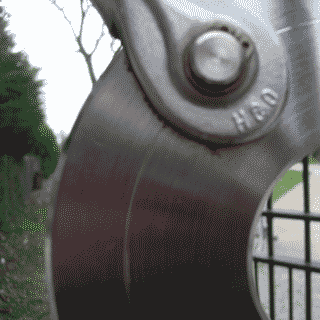Le néon s’éteignit une seconde et se ralluma. Mon visage qui avait disparu réapparut dans le miroir. Je tenais ma tondeuse à barbe et de mon autre main tendais la peau de mon cou pour ne laisser échapper aucun poil. C’est étrange, pensai-je, mais cela peut arriver. Je continuai la progression de la tondeuse vers mon menton.
La lumière s’éteignit à nouveau, puis revint dans une sorte d’hésitation langoureuse, avec une progressivité qui me rassura. Des travaux dans le coin, peut-être. Il s’était écoulé une dizaine de secondes.
Il y en eut une troisième.
J’arrêtai ma tonte, attendant la suite. L’intervalle entre les coupures raccourcissait, puis il sembla se stabiliser au rythme d’une toutes les deux trois secondes, tel un stroboscope au ralenti. Mon visage réapparaissait de plus en plus stupéfait.
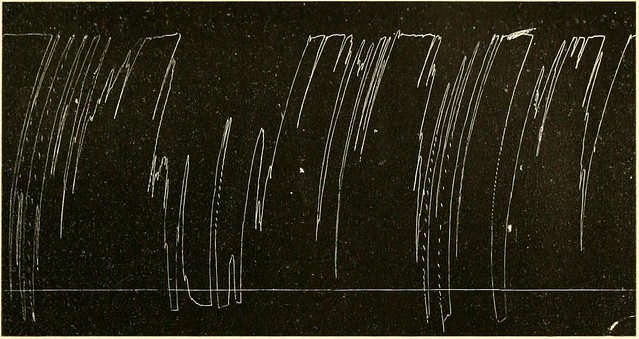
Je posai ma tondeuse et allai au salon. Je n’allumai pas et m’approchai des fenêtres. Dehors dans la nuit finissante, la ville clignotait. Au même rythme que dans la salle de bains. Comme pour adresser un message en morse aux astronautes de la station spatiale. Ou bien à des extra-terrestres en maraude dans ce coin du système solaire. Les deux grandes tours du quartier d’affaires de la Part-Dieu, que l’on surnomme ici le crayon et la gomme, clignotaient aussi. Ainsi que les enseignes rouges sur les toits des quais. Comme le morceau de la basilique de Fourvière qui dépassait au-dessus de l’immeuble en face. Machinalement, je vérifiai qu’il n’y avait personne sur ce toit. Une fois, j’avais vu un couple y faire l’amour couché sur les tuiles, à vingt mètres du sol, et je conservais l’espoir d’en surprendre un nouveau. Je me penchai derrière la fenêtre. En bas, dans la rue, les lampadaires clignotaient aussi.
J’allai chercher mon téléphone et consultai le site du Monde. Rien de neuf depuis la veille. Je me branchai sur le site d’un journal local. Rien non plus. Et sur Facebook. Pareil.
Une dernière fois, cela s’éteignit.
Je dis « une dernière fois », mais je ne savais pas alors que cela n’allait pas se rallumer. J’attendis en vain. Comptant en silence les secondes. Tout était obscur. Comme à la campagne. Dans une forêt. C’était les ténèbres. La nuit. La vraie.
Je m’habillai en vitesse et dévalai l’escalier sans essayer d’appeler l’ascenseur.
J’ouvris la porte sur la rue.
Une masse gris clair gisait sur le trottoir dans la pénombre épaisse. Un corps.

J’hésitai une seconde et me précipitai à son secours. Sous mes doigts, je sentis une tenue de travail au tissu raide. C’était un homme robuste, couché sur le ventre, visage dans le sol. Il avait dû trébucher sévèrement dans la bordure du trottoir. Je pris son poignet, cherchant son pouls.
Il était mort.
Je me relevai, examinai les alentours. C’était une nuit épaisse comme du ciment à prise rapide. J’étais englué dedans déjà, perdu dans ma propre rue. Une lumière rouge diffuse irradiait de l’escalier d’une traboule. Ce quartier en pentes est sillonné de ces passages qui coupent au vif entre les immeubles agenouillés au flanc de la colline. En m’approchant de cette lueur rougeoyante, je trébuchai dans un deuxième corps.
Mort aussi.
Un balai était tombé près de lui comme l’arme d’un soldat. C’est là que je sentis le froid monter de mes reins à mes épaules, ma chemise collée à mon corps par une sueur glacée.

Je m’approchai prudemment de l’escalier. La lumière rouge provenait des feux arrière d’une voiture coincée tout en bas, cul en l’air. Visiblement, elle avait dévalé les marches depuis la rue qui arrivait du dessus. Je descendis vers elle et la contournai. J’allumai la lampe de mon téléphone. Une femme était les jambes sur le volant, tête et torse tassés contre le pare-brise, des cartons répandus autour d’elle parmi une flopée de prospectus pour le candidat du Parti Républicain aux prochaines élections. Je n’avais pas besoin de chercher son pouls pour savoir qu’elle était morte. C’était son décès qui avait provoqué cet accident et non l’inverse, j’en fus certain, sans en avoir de preuves tangibles autres que les deux corps là-haut.
J’eus alors l’idée d’examiner mon téléphone. Plus aucune barre, le réseau était mort.
C’est la fin du monde, pensai-je.
Je partis au hasard. D’autres cadavres gisaient sur les trottoirs et les chaussées. Des lycéens avec leurs besaces. Un vieux chibani emmêlé dans sa canne. Une joggeuse. Un cycliste et son vélo. Il y avait un siège bébé sur le porte-bagages.
Je m’accroupis. L’enfant était versé en biais, crâne dans le sol, ses yeux grands ouverts. Je m’écroulai en chien de fusil sur le goudron, tête dans les mains, mon regard dans son regard mort.
Gilles Bertin
Photos :
- Image from page 355 of « Geriatrics : the diseases of old age and their treatment, including physiological old age, home and institutional care, and medico-legal relations » (1914) — from Internet Archive Book Images Aucune restriction de droits connue
- Pacman’s 19th nervous breakdown OR: Stop smoking — by Rookuzz.. CC BY 2.0
- Image from page 170 of « Elementary and dental radiography » (1813) — from Internet Archive Book Images Aucune restriction de droits connue


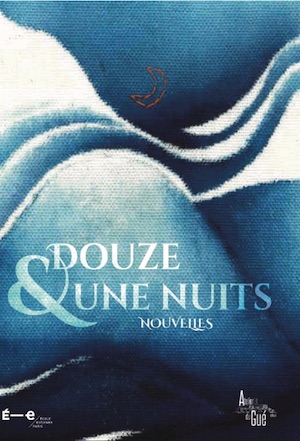 La nuit, tu es à la fois un et une autre, « la nuit, je mens. »* Douze & une nuits est une anthologie sur la nuit éditée par l’
La nuit, tu es à la fois un et une autre, « la nuit, je mens. »* Douze & une nuits est une anthologie sur la nuit éditée par l’