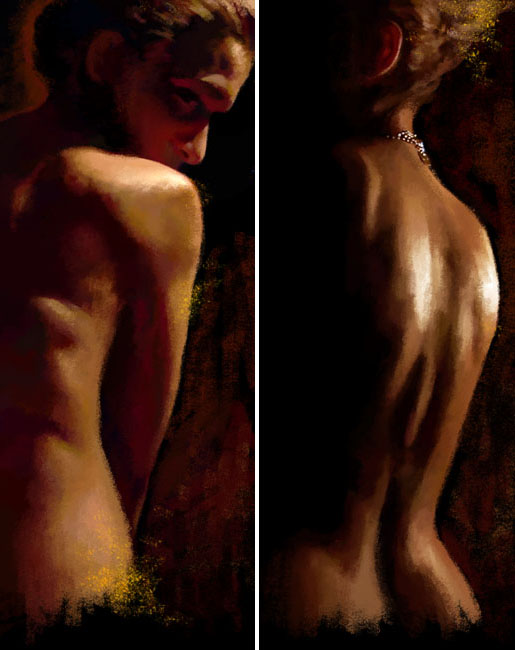« …pourquoi ne pas imaginer, le 1er vendredi de chaque mois, une sorte d’échange généralisé, chacun écrivant chez un autre ? Suis sûr qu’on y découvrirait des nouveaux sites… ». Ainsi sont nés les vases communicants.
Aujourd’hui, Enfantissages et Lignes de vie s’invitent réciproquement. Voici donc :
Lettre au mort inconnu
de Enfantissages
Aujourd’hui c’est ton enterrement. En voyant tout ce monde qui se rend à l’église pour la cérémonie, je me dis que tu es soit un notable, soit un jeune. Je dis « un » parce que, j’ignore pourquoi, je t’imagine au masculin. Et jeune, parce qu’une vie écourtée touche plus les gens. Enfin, c’est ce que je me dis. C’est plus absurde, plus injuste, plus triste que la fin d’une vie longue, qui elle est une chose dans l’ordre des choses. Un jour, il faut bien mourir.
Il y a beaucoup d’enterrements, ici. Ça met de l’animation. Tout à coup les rues du village se remplissent. De petits groupes passent devant chez moi, ou des personnes seules. Celles-ci ont l’air plus graves que celles en groupe, qui mènent conversation. L’air du village se remplit de ce brouhaha éphémère. Vers deux heures d’abord – mais avant la cérémonie les gens sont plus silencieux, plus recueillis, plus anxieux peut-être. Puis après, vers trois heures et demie, ils sont au contraire bavards, je les entends même rire à gorge déployée parfois, ils sont soulagés, c’est fini.
Justement, regardant passer par la fenêtre ceux qui viennent te rendre un dernier hommage, un dernier salut ou une dernière pensée, qui viennent t’accompagner vers ta dernière demeure, comme on dit, je vois une femme rire de bon cœur. Je sens mes yeux se plisser et mes mâchoires se crisper.
Ça me ramène loin en arrière, lors des obsèques de ma grand-mère. Dans les familles sans religion, les enterrements se réduisent parfois à leur plus simple expression. On accompagne le cercueil jusqu’au caveau, on jette chacun son tour soit une rose, soit un peu de terre. Et c’est tout. On se retrouve ensuite quelque part, pour un repas froid.
Pour ma grand-mère, les assistants à l’absence de cérémonie s’étaient réunis au funérarium. Je me souviens, je me sentais très angoissée. Rien ni personne ne m’obligeait à entrer dans la pièce où gisait ma grand-mère, mais je voulais voir, la voir. Je n’avais jamais vu de mort. Ce qui me causait une telle angoisse c’étaient les derniers souvenirs que j’avais d’elle, dans son lit d’hôpital. Couverte de bleus et d’escarres. Elle si digne et si distinguée, si hautaine même, elle qui parcourait à vélo, pendant le couvre-feu, le Paris occupé par les Allemands pour aller délivrer les femmes enceintes, elle qui avait bravé la milice, elle qui, alors que mon grand-père était prisonnier en Pologne, avait élevé seule trois garçons, elle était là, sur ce lit d’hôpital, prisonnière à son tour d’un corps réduit lui aussi à sa plus simple expression, peau sur les os, mains recroquevillées, attachées pour ne pas qu’elle se blesse.
Dans le grand hall du funérarium, j’entends soudain un éclat de rire. La colère me saisit. Ce rire est totalement déplacé, indécent ! Qui vient troubler ainsi le deuil des proches, notre deuil, mon angoisse, mon rendez-vous avec la mort ? Un cousin au énième degré est venu avec sa « copine ». Quel culot ! Elle n’a rien à faire là, elle ne connaissait même pas la défunte ! Et en plus, elle prend ça tellement à la légère qu’elle rit en se trémoussant comme une collégienne ! Je me sens humiliée dans ma peine, dérangée dans mon recueillement, enveloppée dans l’incompréhension hilare de cette inconnue.
Tu vois, toi le mort d’aujourd’hui qu’on va enterrer, ce sont tous ces souvenirs enfouis qui sont soudain exhumés quand j’ai entendu rire cette femme, sur le chemin de l’église. Mais laisse-moi te raconter encore, ça me fait du bien. Tu es un confident attentif.
J’étais entrée dans la pièce, seule. Mes parents m’y avaient gentiment encouragée. Elle reposait dans son cercueil, vêtue avec cette bourgeoise élégance dont elle ne se départait jamais de son vivant. Ses joues étaient d’un rose délicat, comme son gilet en cachemire. Elle semblait respirer, j’aurais juré, fascinée, voir d’imperceptibles soupirs soulever ses paupières, gonfler ses joues, agiter ses lèvres. Elle dormait. Le thanatopracteur avait bien fait son travail. Il lui avait rendu sa dignité, elle avait retrouvé la paix.
J’aurais voulu la toucher. Sa peau discrètement fardée avait l’air si douce et veloutée. Peut-être que la chaleur du corps avait été conservée, elle aussi ? Mais malgré mon esprit entièrement tendu dans cette ultime caresse, je n’osais pas plus que de son vivant. Car tu vois, je retiens tellement souvent mon geste, qu’il n’en reste que mon désir ardent de tendre une main qui reste obstinément immobile.
Comme le jour où je me suis retrouvée au pied du Mur, à Jérusalem. Je m’en étais approchée le plus près possible, je veux dire, le plus près qu’il me semblait possible sans déranger les femmes en prière qui m’entouraient. Je pourrais presque aller jusqu’à dire que j’étais prise de cette crainte divine, de cette sainte terreur de Dieu, frappée de « awe » comme disent les Anglais. Je contemplais ce mur vieux de plus de deux mille ans, vestige sacré d’un temple, non, DU Temple, dont chaque fissure, dont chaque interstice étaient remplis, non pas de mousse, ou de ruines de Rome, mais de centaines de milliers de minuscules bouts de papier pliés. J’aurais tellement voulu y poser la paume de ma main et sentir contre ma peau ses rugosités ocres que j’ai cru l’avoir fait, que c’est comme si je l’avais fait.
Tu vois, finalement, après le rire on en revient aux Lamentations. Mais on frappe à la porte. C’est Jean, un voisin. Il vient nous rapporter la faux que nous lui avons prêtée. Je l’aime bien Jean, il a l’air vraiment gentil. Et là, il fait preuve d’un humour dont, je ne sais pas pourquoi, je ne l’aurais pas cru capable. Il nous raconte que, passant devant l’église où s’amassait la foule éparpillée pour assister à la cérémonie funèbre, il s’était senti « un peu mal à l’aise, avec cette faux sur l’épaule, un peu comme, vous savez comme on dit, hein, comme la … vous savez… la Faucheuse, quoi ! » Et il a eu ce petit rire discret que j’apprécie beaucoup chez lui. Je te rassure, il semblait authentiquement gêné d’avoir accidentellement joué un rôle, sinon dans ta mort, du moins dans tes obsèques !
C’est à ce moment-là que je me suis dit que tu devais avoir un sacré sens de l’humour, passe-moi l’expression, enfin si j’ose dire. Tu es là, quelque part, j’en suis sûre. Et le jour de ton enterrement, c’est toi, en réalité, qui, du haut de ton invisible évanescence, suscite le rire chez les vivants, ce rire qui soulage et qui détend. J’aurais bien aimé te connaître, tiens.
D’autant que tu m’a fait vivre un instant comme on en vit trop peu. Une rencontre avec un ange. Je suis sûre que tu étais là aussi, à ce moment-là, quand nos regards se sont croisés. Je sais, c’est un détail trivial, mais aujourd’hui j’ai mis mes rideaux à la machine. Et tous les gens qui passent devant chez moi ne peuvent pas s’empêcher de regarder à l’intérieur. Oh, je ne leur en veux pas, c’est un réflexe, moi aussi je fais la même chose chez les autres. Mais tout de même, c’est assez agaçant ! Tu dois bien rire de mes petits soucis, toi que plus personne ne peut voir, toi qui désormais perce à jour sans effort l’âme des vivants, rideaux ou pas.
C’est comme ça que nos regards se sont croisés, à travers la fenêtre. Qu’il était beau cet ange… Nos regards se sont croisés et spontanément nous nous sommes souris. Un instant hors du temps. Merci à toi, je ne te le dirai jamais assez. Sans toi, je ne l’aurais jamais vue, elle et son sourire rayonnant. Rayonnant, je le dis au sens plein et vrai du mot. C’était toute sa personne qui rayonnait, qui répandait de la lumière, qui irradiait la sérénité. Et ce sourire qui est comme une porte vers la plénitude infinie, on ne le rencontre qu’un tout petit nombre de fois dans une vie. Ces quelques secondes d’éternité resteront gravées pour toujours en moi.
Avec un tel ange venu pour t’accompagner, tu ne pouvais être que quelqu’un de bien. J’en suis certaine. Il ne peut en être autrement.
Mais voilà que pour les gens qui sont là, tout est terminé. Tu es mort, tu es enterré. Voilà. C’est fait. C’est fini.
Comme les cloches avaient sonné le commencement, elles sonnent maintenant la fin. Et chacun rejoint sa voiture, petit à petit, les rues se vident, la clameur retenue se désagrège, les portières claquent, les unes après les autres. Le silence reprend possession des lieux. Ce silence qui abrite le chant des oiseaux et des arbres dans le vent. Lui, qui planant sur ta tombe fraîche couverte de fleurs coupées, veille désormais sur toi.
Alors moi aussi, je te dis au revoir, à toi, le mort inconnu qui a illuminé ma journée.
Texte de Enfantissages
Voici le chemin vers mon texte chez ma complice,
l’occasion aussi de découvrir sa poésie
Les autres Vases communicants :
Humeur Noirte et Anna de Sandre
L’exil des mots et Juliette Mézenc
Petite Racine et Scriptopolis
Robinson En Ville et le Fourbi Élastique
La Méduse et le Renard et Etc-iste
Anne Savelli et Christine Jeanney
LeRoy K. May et Marie-Helene Voyer
PCH de PDLW et L’Employée aux écritures
« A chat perché » et Anthony Poiraudeau