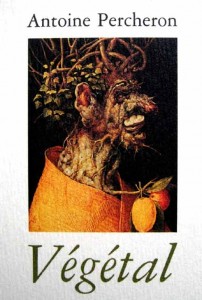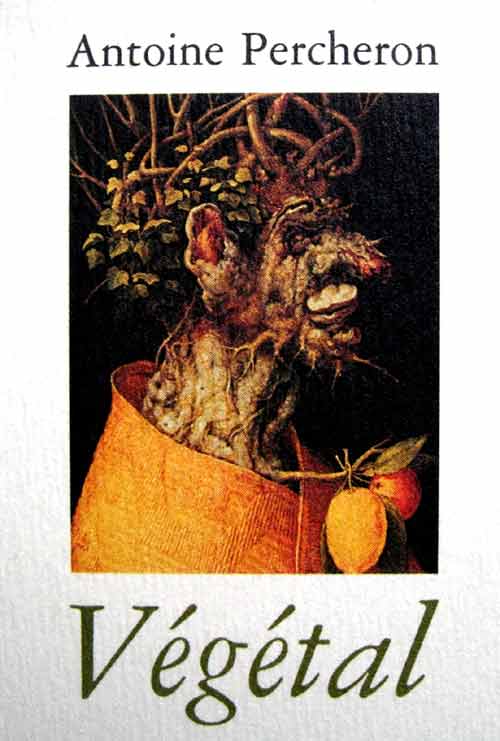Première partie de deux : la suite et fin est ici.
Une veste à vingt euros ! J’ai le coup de foudre. Me vois déjà dedans. Tends mon unique billet à la vendeuse. L’endosse, me va sacrément bien, juste ma taille. Une fille qui passe me sourit intensément. Menuette comme je les aime, gambettes fluos dans l’étui de sa jupette. Cette veste me porte déjà bonheur ! Vaut mieux vu que je viens de flamber d’un seul coup ma paye de la veille. Je fais le Père Noël pour les Nouvelles Gales : piétiner avec du coton au menton, les boules dessous, les pieds gelés dans des pompes aux semelles qui se tirent. C’est ma manière à moi de lutter contre le chômage, de contribuer à la chute des statistiques fatales, de travailler plus que pas du tout.
Je poursuis ma Sainte Vierge polychrome parmi les étals du marché Saint-Bru, entre les demi-bobos qui s’encanaillent à la recherche d’une bonne affaire. Elle se retourne, mine de rien. T’inquiète poulette ! je suis bien là. Rue Nicolas Chorier, je hèle un nuage de guimauve en maraude : Suivez-moi cette femme indiscrètement.
– Accepteriez-vous que je vous offre un rêve ? lui dis-je, alors qu’elle farfouille dans les casiers à bouquins d’occase de Gibert.
– Why not ? me répond-elle, avenante.
Nous deux, Place Grenette, devant deux ambrées de Noël. Conversation légère de deux humains de sexe pas si opposé que ça. Cheveux bouclés copeaux brunis, yeux acier bleu, pommettes assaillantes, et ce creux derrière où j’ai envie de voir la sueur perler. Bon dieu !
– Tu t’appellerais pas Elsa ?
Elle rit.
– Non, je m’appelle Marie.
– Alors moi, c’est Joseph !
On s’esclaffe. La quitte un instant pour les toilettes. Jubilation en pissant, mais quand je reviens, plus de Marie, plus de veste.
Aurais-je rêvé ? Nos demis à demi bus sont encore sur la table. Entre les deux, le ticket déchiré.
Dehors, ni Marie, ni Elsa. Je cours le long des rails du tram. Cette veste, c’était celle du bonheur, je me sentais fort dedans, j’allais devenir.
En passant devant un lavomatique, je la vois. Ma veste ! En train d’enfourner du linge dans le tambour d’une machine à laver. Entre dans la lavobidule. Empoigne le type. Il s’enfuit. Cours derrière. Rue Chenoise. Aperçois dans une boucherie ma veste sur la grande robe blanche d’une femme. Entre. Déjà ma veste est repartie. Cours. Ma veste partout. Galope comme un cheval emballé dans cette ville qui ne veut pas de moi, dans cette cité imprécise et impérieuse qui me hante, quadrillée de rues glauques. Grenoble, l’esprit d’innovation et les nanos technos, le ski et le sky bleu comme les yeux de Marie, la Chartreuse et son jambon de Parme, Stendhal and tutti quanti, mon cul. Traverse la place du Tribunal, arrive au jardin de ville, hors d’haleine. Louis, un black qui crèche dans le squat est là.
– Calme-toi, il me dit, faut pas s’énerver dans la vie.
Je lui raconte. Il rigole.
– T’en fais pas, t’en retrouveras une beurette pour tes burettes.
– Tu comprends pas Louis, je l’aime plus que jamais j’ai aimé personne.
Il me prend l’épaule dans sa main gigantesque et me secoue.
– T’es maso, elle te pique ta veste et tu tombes raide d’elle ! Prends-toi une bonne murge comme tu sais le faire et roule-toi deux trois gros péts de derrière les fagots : demain, fini, tu l’auras oubliée ta Vierge Marie !

Photo-montage Lignes de vie / Fête des lumières Lyon 2009
– T’es pas un vrai Père Noël !
J’ai repris mon poste de bon papa enguirlandé aux Nouvelles Gales. Dernier jour de taf, demain : retour au chômedu, sans beurre et sans reproche, sans emploi ni jacuzzi.
– T’es pas un vrai Père Noël ! répète la petite Carole.
Je la regarde avec une sévérité astringente. Pourrait faire semblant au moins ! Comme les autres. Pas nier mon rôle social ! Mais un Père Noël, ça fout pas de claque aux fillettes impertinentes. Gentil, gentil. Calme ! Fourre ma main glacée dans ses bouclettes. Si ! Je suis un vrai. Regarde ma red pelisse synthétique, ma barbe à papa, ma hotte osier Made in China. Ose dire le contraire Carolinette. La soulève contre moi. Maman, une blonde Dessange, s’affole dans son sac à main. Clic-clacs du doigt ganté de pécari. Photos inoubliables de la petite quand elle croyait encore au père Lustucru. Et Carolinettounette dans mon oreille :
– Les Pères Noël c’est vieux, toi t’es jeune !
Chuchotis à mon tour dans les cheveux vermicelles, pendant que mère nous encadre sur l’écran de son numérique : « CAROLE, LE PERE NOËL N’EXISTE PAS ! On me paie pour faire croire le contraire. Faut que tu continues à faire semblant. Ta maman en a besoin. Elle y croit, elle. Promets-moi de rien lui dire. » Carole rit quand je la repose sur le trottoir. Se retourne en s’éloignant avec maman pour un clin d’œil. Me fait coucou de sa menotte. Good, cette complicité enfantine pour mon intérieur. Besoin de calfeutrer mon home depuis que Marie s’est envolée avec ma veste.
Je cent-patte devant la vitrine pelucheuse. Nounours nougats. Poupées poufiasses, santons cent euros, sapins poupins. Vais jusqu’au clodo qui aumône dans les eaux territoriales des Nouvelles Gales. Demi-tour. Repasse devant les portes automatiques sous l’œil poissonneux du maousse de la Securitat. Nouveau demi-tour vers le manège d’autrefois qui Piaf. Temps égrené par les trams qui prennent le virage de la place Grenette. Je pense aux galbes de Marie, le boeuf et l’âne doivent se rincer l’oeil en ce moment. Si c’est vrai que le petit Jésus existe, ce dont je doute en ce qui me concerne vu que j’ai pas de carte Gold, alors ma sainte Marie resdescendra sur Terre un de ces quatre matins mais, en lieu et place, c’est Jean-Denis Gabon qui se matérialise devant moi, sa seigneurie le directeur du magasin himself et en personne.
– Vous n’êtes pas assez vendeur, me reproche-t-il, il faut aller au devant des enfants, leur sourire, être gentil.
Moi, j’ai pas envie d’être gentil, mais c’est lui le chef, il tient les rênes et les cordons de ma bourse. Certain de lui, il me débite son sermon d’école de commerce et, devoir accompli, retourne derrière la transparence épaisse de ses portes Securit d’où il me surveille encore un moment, m’obligeant à me remettre à mon tapin.
C’est à ce moment qu’elle surgit.
Marie !
Carole, la gamine de toute à l’heure, la tire par la main jusqu’à moi :
– C’est ma baby-sister, elle veut pas croire ce que vous m’avez raconté, que le Père Noël il n’existe pas.
Je reste coi, enseveli sous les cent mille pétales de roses du regard de Marie. Il vaut mieux que je me taise de toute façon, je ne voudrais surtout pas qu’elle me découvre sous ce déguisement ridicule.
– C’est pas exactement ça, fait Marie.
Elle se penche vers moi, m’offrant son intimité en plasma seize-neuvième, c’est Noël au balconnet et à Pâques, c’est certain, je serai total givré. Elle s’approche de mon oreille glacée comme une meringue sur une bûche et me chuchote :
– Sa mère veut qu’elle continue à croire au Père Noël, alors moi aussi je fais comme toi : je fais comme si.
– Regarde Marie, s’exclame Carole.
La petite furie se cramponne à ma barbe qui lui reste entre les mains.
– Joseph ! crie Marie en plaquant ses mains sur sa bouche.
Et elle détale.
Suite et fin mercredi jeudi 24 de l’an 2009 after dj-save….. ELLE EST là, la la la…..