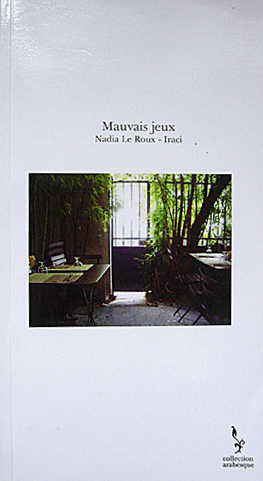Anna de Sandre m’a invité pour ces Vases communicants d’août (le premier vendredi de chaque mois, des auteurs s’invitent dans un échange de textes sur leur blog). J’ai accepté aussitôt, j’aime son écriture sans morale ni fanfreluche, « couillue » et sensuelle. Vous pouvez me lire ici, sur le site d’Anna.
Voici donc :
L’essayage
de Anna de Sandre
.
C’était à la fois étrange et reposant de glisser dans ses vêtements, de les essayer un à un en remontant le décolleté d’un col en V sur mes seins trop gros ou en tournant une jupe un peu flottante à ma taille. Ses chaussures étaient entassées sans distinction dans un sac poubelle. Je chaussais deux pointures au-dessus et ne souhaitais pas les donner à quiconque.
Un peu de givre sur la fenêtre durcissait avec la fin de la journée et ma respiration sortait en volutes dans la chambre comme d’une opportune cigarette. Les radiateurs éteints depuis ces jours derniers ne m’indisposaient pas. La succession des essayages laissait même une fine sueur sur le haut de mon corps qui alourdissait l’odeur de mon parfum. J’enchaînais les gestes devant les glaces de l’armoire avec rapidité, non pas à la sauvette mais sous l’impulsion d’une frénésie. Je n’attendais rien de mon reflet qui renvoyait mon image affublée de ses fringues. Juste mon sourire dont je ne savais plus s’il était victorieux ou gêné, un peu des deux je crois, en remarquant les moitiés de son lit que je partageais en me tenant debout trois pas devant. J’avais baisé sur sa couette en satin avec un voisin qui n’en demandait pas tant après m’avoir aidée à porter quelques-uns de ses meubles à la déchetterie. Je n’avais pas osé aller jusqu’à ouvrir sa couche pour me tordre et hurler dans ses draps inchangés depuis qu’on l’avait enlevée.
C’était la semaine précédente seulement et j’avais l’impression de rouvrir sa chambre après avoir vécu une longue vie loin de son appartement, ailleurs que dans cette ville où j’avais enchaîné des jobs lamentables pour l’entretenir et lui payer ses putains de médicaments.
Son téléphone bleu, assorti au monochrome de la chambre, prenait la poussière. Elle fut la seule à s’en servir, rarement. En entrant ici, on faisait rapidement le tour de ses possessions, de ses propriétés. Un territoire petit et mal entretenu qu’elle quittait à regret, pressée par tout ce qui pour elle était une obligation. La décence lui interdisait tout juste le pot de chambre et la toilette de chat, et je la croisais quelquefois dans ses peignoirs et ses robes de chambre. Rarement vêtue pour sortir. J’étais sa meilleure domestique et j’expédiais ses affaires courantes sans jamais faillir, j’avais trop peur d’en mourir.
Les cloches de Saint-Bénigne sonnèrent l’heure. J’adressai un adieu muet au téléphone, au lit et aux miroirs qui me montraient dans son manteau-redingote favori d’un agréable vert bouteille, je humai un reste de son parfum à l’ylang-ylang accroché sur son pull à col-boule en cachemire gris perle et je sortis de mon sac à main un échantillon de bois de cade pur jus que j’ouvris et répandis par frottements sur le chambranle de sa porte. Il chasse les sorcières à tous coups et je ne souhaitais pas qu’elle me jouât un nouveau tour, même à présent que je l’avais vaincue.
L’oncle Jacques, impatient de se recueillir une énième fois au pied de son lit, apparut dans l’embrasure.
L’effroi lisible sur son visage fut une nouvelle victoire.
Mon texte La lame est ici, chez Anna.